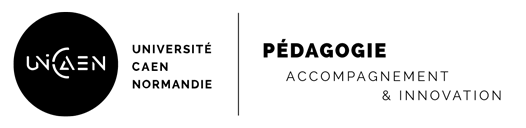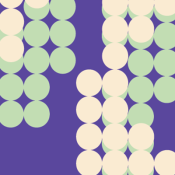Retour d’expérience sur la co-animation d’une UE sur les pratiques écoféministes par une enseignante et une compagnie de danse.
Suite à la découverte de la compagnie Noesis lors du colloque Redécouvrir Françoise d’Eaubonne (novembre 2022 à l’IMEC et la MRSH), Muriel Gilardone, maîtresse de conférence en économie, et Flora Pilet, chorégraphe, ont construit un jumelage en lien avec le cours « pratiques écoféministes » des UE pluridisciplinaires « études sur le genre » (optionnelles en L3 économie, géographie, philosophie, sociologie et histoire). Muriel Gilardone revient ici sur le changement radical de posture enseignante que cela a provoqué et sur la richesse du processus pour les étudiantes et étudiants.
Comment est venue l’idée de ce jumelage ?
L’idée a émergée lors d’échanges informels autour de nos explorations respectives des pratiques et des perspectives écoféministes dans nos activités – Flora dans ses créations artistiques mais aussi dans ses projets de médiation culturelle, moi dans mes questionnements de recherche sur la justice sociale et environnementale, mais aussi dans mon envie de faire évoluer mes pratiques d’enseignement pour les rendre plus « vivantes » et plus « circulaires ». Comme la plupart des personnes ayant assisté au colloque Redécouvrir Françoise d’Eaubonne, j’avais été très touchée par la façon dont Flora et Coline Pilet avaient rendu compte de leur rencontre avec cette penseuse, autrice, dessinatrice, activiste tombée dans l’oubli et dont on réédite depuis peu les nombreux ouvrages précurseurs à bien des égards du mouvement écoféministe, à commencer par la formulation du terme « écoféminisme » lui-même. Dans leur contribution, elles ne nous avaient pas proposé une mise en scène de sa pensée ou de ses idées, mais plutôt une exploration dansée et théâtralisée de ce que ça leur avait fait de lire ses écrits intimes déposés à l’IMEC, tout en découvrant ses ouvrages de fiction et de pensée politique. En exposant ce qui les avaient traversées dans cette rencontre, en lien avec les questions qu’elles se posaient, elles, aujourd’hui, elles avaient réveillé en moi l’envie de partager et transmettre la puissance d’intégration et de transformation que permet une « approche relationnelle » de la connaissance (cf. Estelle Zhong Mengual, 2021, Apprendre à voir, Actes Sud). J’étais aussi en train de préparer un cours sur les pratiques écoféministes dans le cadre des toutes nouvelles unités d’enseignement « études sur genre », et je savais qu’un cours magistral standard était totalement inapproprié pour ce sujet. C’est pourquoi j’ai sauté sur l’occasion quand Flora m’a parlé de la possibilité d’un jumelage financé, entre autres, par la DRAC.
C’est donc le sujet du cours – les pratiques écoféministes – qui a permis ce jumelage avec une artiste ?
En grande partie, oui. En tout cas, c’est par cohérence avec le sujet des pratiques écoféministes que j’ai osé sauter le pas d’une approche pédagogique à la jonction arts-sciences. Ces pratiques visent le plus souvent à rompre avec la logique de pouvoir dans le partage de connaissance et le développement de compétences ; elles cherchent à décloisonner ce qui relèverait de la rationalité et de la créativité, de la raison et des émotions, des savoirs théoriques et des savoirs expérientiels. Les pratiques artistiques jouent donc un grand rôle dans ce mouvement social, philosophique et politique. Mais je parlerais plutôt d’un « déclencheur », que d’une condition nécessaire.
En fait, cela fait plusieurs années que je tâtonne autour d’innovations pédagogiques visant à ramener plus de présence en cours, et d’appropriation de savoirs théoriques, historiques ou philosophiques parfois très loin des préoccupations premières d’un public étudiant. J’avais très envie d’expérimenter des façons d’enseigner l’histoire des idées économiques et des pensées politiques qui seraient moins « scolaires », « dépersonnalisées », et souvent à première vue inutiles dans une perspective d’insertion professionnelle et d’acquisition de compétences directement « opérationnelles ». J’avais bien sûr cherché à problématiser mes enseignements en les ramenant à des enjeux de société essentiels et qui, je le savais, les préoccupaient. Mais je voyais que le procédé du cours magistral standard installait très vite une distance avec la connaissance transmise – quand ce n’était pas un désintérêt –, alors que mon intention était plutôt de proposer une expérience de cours nourrissante et transformatrice. Or, je n’ai pas eu beaucoup de modèles d’« autre chose » que ce fameux cours magistral, plus ou moins « animé », et « interactif ». Il se trouve cependant que la même année où j’ai construit ce projet de jumelage avec Flora Pilet, j’avais programmé dans le cadre d’un cours d’histoire de la pensée économique une conférence-spectacle de Vanessa Michel sur Adam Smith, qui m’avait elle aussi mise sur la piste d’un savoir relationnel et mêlant des techniques académiques et artistiques, relevant du théâtre en l’occurrence. J’avais ainsi pu observer l’effet sur le public étudiant, et même enseignant, de la transmission de savoirs par une conférence « théâtralisée », et parlant aussi de ce qu’avait apporté et transformé la rencontre avec un penseur mort depuis 250 ans et une enseignante-chercheuse bien vivante, à la fois dans sa propre pensée d’économiste, et dans la façon de transmettre celle de son prédécesseur, Adam Smith. Je commençais donc à percevoir les potentialités d’un changement de posture dans le rapport au savoir et à sa transmission.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce changement de posture ?
Et bien, il y a plusieurs éléments qui modifient nécessairement la posture habituelle. En premier lieu, je n’étais plus seule à penser le cours et à l’animer. L’idée était de nourrir l’enseignement de nos deux regards et approches du sujet, non pas en les juxtaposant, mais en tissant une proposition co-construite pour chaque cours, avec un fil conducteur général. C’était une première pour nous deux, nous avions des habitudes de travail très différentes et des agendas laissant peu de place à des séances de travail ensemble. Heureusement, nous avions pu découvrir nos approches et travaux respectifs en nous rencontrant sur d’autres projets comme le projet de médiation culturelle Ce à quoi nous tenons ou le projet de recherche participative Échanges interdisciplinaires avec les plantes. En tout cas, l’idée générale pour cette expérience de cours ensemble, nous l’avions formulée au moment de l’écriture du dossier de jumelage : prendre comme support commun la notion de « paysage », et la considérer à l’aune des pratiques écoféministes, incluant des pratiques académiques et somatiques complémentaires, permettant de discuter et de sentir notre inscription dans le paysage appréhendé à différents niveaux, différentes échelles.
En second lieu, il s’agissait à travers ce jumelage de proposer de nouveaux « rituels » de cours, et ce faisant de proposer une réflexion sur la notion de « rituel » très présente dans les perspectives écoféministes. Et là, l’un des défis pour moi, c’était de laisser la place à l’expérimentation, à la nouveauté, à la perspective créative sans perdre de vue le besoin de transmettre de connaissances et compétences attendues dans une formation universitaire. Il y avait une forme de tension liée à l’importance de « tenir » l’espace tout en acceptant le jeu d’aller au-delà des frontières habituelles. C’était à la fois stimulant et troublant, pour moi, pour Flora aussi je pense, mais également pour les étudiant.es. Ce qui a permis de rendre les choses plus faciles, c’était d’assumer le côté expérimental, et même de recherche-action pédagogique, avec des exercices de réflexivité en fin de séance, rendant possibles les adaptations au groupe et à ses besoins en matière d’apprentissage, tout en cherchant à éveiller le désir et la curiosité pour d’autres façons d’apprendre plus engageantes, actives et vivantes. Autrement dit, notre objectif était de sortir les étudiant.es d’une posture de réceptivité pure, et du confort apparent que peut procurer le fait de prendre en note un cours bien construit sans avoir à s’exprimer ou à contribuer d’une façon ou d’une autre. D’un coup, il ne devenait plus possible de se cacher au fond de la classe ou derrière sa concentration de prise de note. Nous voulions entendre toutes les voix et mettre en mouvement tous les corps, les faire s’exprimer, se rencontrer et s’accorder mais aussi s’« individuer ».
Quelles techniques pédagogiques ou artistiques avez-vous utilisées pour cela ?
Nous avons d’abord cherché à créer un « climat » propice à la rencontre, l’expression, l’écoute et l’expérimentation. Un rituel de début de cours consistait déjà à reconfigurer l’espace de la classe en retirant les tables et les chaises ; c’était déjà une façon de réactiver les corps et de préparer les esprits pour l’accueil de la nouveauté. Ce rituel était complété de propositions, par la chorégraphe, de pratiques somatiques permettant d’explorer le paysage nouvellement composé dans la salle de cours. Les pratiques somatiques sont des méthodes de prise de conscience du corps en mouvement dans l’espace ; ce sont en quelque sorte des « mises en corps » visant aussi – et c’était important dans ce cadre – un « accordage » du groupe. Ces différentes propositions de revisite de l’environnement quotidien, et de conscientisation de la façon dont les corps l’habitent ont permis d’amener de la présence à soi, mais aussi d’attention aux autres et à ce qui nous entoure. Ensuite, nous pouvions aborder, avec une compréhension plus sensible, les questions soulevées par les perspectives écoféministes, sachant que parmi ces questions, deux sont particulièrement centrales : la question de l’exploitation des corps (en premier lieu, ceux des femmes), et la question de la place et du rôle de l’humain dans le tissu du vivant. En effet, ces perspectives sont, pour beaucoup, issues de luttes de femmes pour défendre les terres dont elles vivent à un moment très critique où celles-ci deviennent appauvries, polluées, déforestées, nucléarisées – avec des répercussions importantes sur les corps des vivants humains et autres qu’humains. Au-delà de la contestation politique, elles ouvrent une voie pour appréhender les écosystèmes ou milieux de vie de manière riche, organique et pérenne. Et il s’agit bien de ne pas laisser cette responsabilité aux femmes seules, d’où l’importance d’une approche pédagogique expérientielle qui amène à déjouer les stéréotypes de genre quant à la sensibilité humaine et la prise en charge du soin de soi, des autres et son milieu. Pour proposer ces expériences, nous nous sommes appuyées sur différents exercices et moyens d’expression comme la lecture à haute voix de textes fondateurs, le partage de connaissances sur un sujet (des recherches préalables avaient été demandées aux étudiant.es), de la mise en scène en petits groupes d’images et de mots-clés évoquant les analyses étudiées et redessinant l’espace du cours à l’aune de compréhensions nouvelles des thématiques abordées par le mouvement écoféministe. Nous avons même terminé le semestre par un cours « hors les murs », en allant rejoindre à pied l’exposition « Nous sommes Orne » proposée par Territoires pionniers au Pavillon et cherché ensemble à comprendre comment cette exposition résonnait avec les perspectives écoféministes, mais aussi avec leurs propres concernements. La marche fut l’occasion d’une proposition d’expérience sensorielle de marche les yeux fermés – guidée par un binôme voyant bien sûr – pour découvrir la ville sous un autre angle. Cette expérience fut mémorable et a permis d’arriver au Pavillon dans un état de réceptivité des œuvres autour de l’eau qui traverse notre territoire bien plus aiguisé !
Avez-vous relevé des résistances du côté des étudiant.es ? Globalement comment ces propositions amenant également un changement de posture étudiante ont-elles été reçues ?
En effet, il y a eu quelques résistances au début, ou a priori lorsque j’ai annoncé le partenariat avec une chorégraphe pour ce cours. Mais de façon générale, cela a plutôt suscité de la curiosité et on a observé un changement très fort dans le groupe au fur et à mesure des séances. Si les exercices proposés pour ramener de la conscience sur les corps ont parfois été accueillis avec difficulté (et pourtant, c’était souvent extrêmement simple, comme marcher ou respirer en conscience), très vite il y a eu un bénéfice de ces pratiques pour les échanges, le climat relationnel, l’implication de toutes et tous, et même une redescente de la pression qu’il y a souvent en cours quand on amène les étudiants et étudiantes à prendre la parole, présenter leurs recherches. La possibilité de pouvoir bouger dans l’espace et de se l’approprier en l’aménageant de façon créative et réflexive a aussi permis une plus grande attention à ce qui se passait en cours. Un étudiant a même souligné que cette liberté d’être, de faire et de se mouvoir lui a donné la sensation d’une plus grande liberté de penser. Plusieurs étudiant.es ont relevé que ces expériences ont permis de « faire groupe », de se découvrir d’une autre manière, parfois plus profonde pour celles et ceux qui avaient l’habitude de se voir en soirées par exemple, une étudiante a aussi souligné que cette expérience l’avait « ramenée à la fac » alors qu’elle commençait à sombrer dans une dépression. Ce qui a aussi été fort pour Flora et moi fut d’entendre un étudiant racisé nous dire, après une lecture collective et un partage de connaissance, que pour la première fois dans ses études il avait pris la parole en cours et eu le sentiment de faire partie d’un ensemble.
Qu’est-ce qui restera de cette expérience selon vous ?
Je crois que je n’avais pas réalisé à quel point cette expérience serait une mise en acte de l’un des mots-clés des pratiques et pensées écoféministes : reclaim. Ce terme n’a pas été choisi par hasard comme titre de la première anthologie de textes écoféministes par la philosophe Emilie Hache (Reclaim, Editions Cambourakis, 2016). Comme l’avait déjà souligné Isabelle Stengers en 2014, ce terme a l’avantage en anglais de renvoyer à la fois au registre de la régénération (par exemple quand on réhabilite des sols ou des relations abîmées) et de la lutte (quand on réclame, reprend ce dont on a été dépossédé.es). Autrement dit, c’est l’idée de guérir et/ou reconstruire un rapport à soi, aux autres, au monde sur de nouvelles bases. Et cela ne peut passer que par le fait de faire vivre des alternatives, de changer de récit, changer d’expérience ; pas juste dénoncer des structures inégalitaires, non soutenables ou peu propices à l’émancipation. Il faut donc expérimenter ensemble et voir ce qui change en nous, dans nos rapports, dans le monde, et prendre le risque de se planter, ou de ne pas y arriver tout de suite ou parfaitement. Le fait d’avoir pu le faire à deux, avec le soutien de mes co-porteuses des UE « études sur le genre » Irène-Lucile Hertzog et Pauline Seiller, du CEMU, du SUAC, de deux UFR et de la DRAC a donné de la force à cette expérience, a permis d’aller plus loin dans une approche relativement « originale » de l’enseignement universitaire.
En tout cas, les retours d’expérience positifs de la part des étudiant.es confortent mon envie de chercher des approches pédagogiques qui rendent plus libre la parole étudiante et de proposent des outils pour cela, sans pour autant négliger le besoin de construire des raisonnements documentés. En gros, je cherche maintenant, et au-delà de ce cours qui était parfait pour une première expérimentation, à faire beaucoup plus se rencontrer les savoirs académiques et les vécus et concernements étudiants, et aussi à faire une place pour l’attention aux corps en présence, à la façon dont on habite un espace de cours, ou encore à la créativité qui est quand même une grande source de joie ! Et là, il me semble que les universitaires, nous pouvons apprendre beaucoup des pratiques artistiques si l’on veut « régénérer » nos façons d’habiter l’université et de transmettre. D’où la bonne nouvelle, de mon point de vue, de cet appel à projet « innover sans numérique » qui peut permettre des expériences d’interventions à deux voix ou des financements de pratiques artistiques complémentaires au cours qui peuvent lui donner une autre portée.
Un podcast a été enregistré, avec Muriel Gilardone, Flora Pilet et trois étudiant.es, à la fin de cette expérience et est disponible sur le site de Radio Phénix.
Un appel à projets « Innover sans numérique »
Si une solution a pu être trouvée pour soutenir cette initiative qui ne rentrait pas dans les cadres habituels des Appels À Projets (AAP) du CEMU dédiés à l’innovation pédagogique, la réussite du projet a fait émerger des besoins particuliers. Pour y répondre, un nouveau format d’AAP « Innover sans le numérique », a vu le jour en septembre 2024.
Plus d’informations
Retrouvez toutes les informations sur le projet Réussites Plurielles.
Contactez votre ingénieur ou ingénieure pédagogique référent pour toute demande d’accompagnement.